Extrait d'un roman de Mona Prince
Traduit de l'arabe par Stéphanie Dujols
"Sur le fond de guerre en Iraq, Mona Prince plonge dans l'univers de sa génération pour révéler le dilemme d'être à la fois à l'écart de ce qui se passe et en plein dedans. Nous publions un extrait de son roman Trois Valises pour partir"
La pensée de midi 2/2004 (N° 12), p. 71-77.
Au début de l'année, le téléphone a sonné peu avant l'aube. C'était Abderrahmane. L'Iraq venait d'être bombardé. Je n'ai pas compris. Comme si j'avais brusquement perdu la parole, j'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose et je n'ai pas réussi ; elle est restée ouverte un moment, puis je l'ai refermée.
J'ai reposé le combiné et me suis assise sur mon siège, les yeux au plafond. J'ai bien fermé la fenêtre et éteint la lumière. Puis, je me suis assise par terre en tailleur, la main sur la joue. Je suis restée comme ça jusqu'au lever du jour. J'aurais voulu courir pieds nus à travers les rues … Mais je ne pouvais pas. Ma mère a frappé à la porte de ma chambre ; elle n'avait pas encore écouté les informations. Elle m'a regardée par terre d'un air de reproche. Elle a fait : « Le petit déjeuner est prêt ». J'ai répondu : « L'Iraq vient d'être bombardé ».
Je suis partie en voiture sillonner la ville. La brume enveloppait les immeubles, les arbres et les rues, je n'y voyais rien. J'ai allumé la radio et tendu l'oreille. La speakerine a annoncé le déclenchement de l'agression américano-internationale et légitime contre l'Iraq, l'élève rebelle. Ainsi débutait la guerre du Golfe, comme on se plaît à dire en Orient. Tempête du désert. Le bulletin d'informations s'achève, suivi de l'hymne à la grande nation … Le rêve effondré.
« Ma patrie, ma chère et grande patrie, plus glorieuse jour après jour
Victoire après victoire, elle grandit et se libère,
Ma patrie, ma patrie … ».
Impossible d'écouter cet hymne utopique à un moment pareil. De quelle patrie parle-t-on ? De quelles gloires, de quelles victoires ?
Le rêve … Tout le rêve des générations qui nous ont précédés, jusqu'au début des années 1970. Il en restait quelques bribes pour notre génération, jusqu'à cet instant-là. Nés et élevés dedans. Et voilà qu'il s'évanouit à jamais devant nos yeux, pour rejoindre les vestiges du passé, des temps anciens. Chimères … Pourra-t-on encore parler du nationalisme arabe à nos enfants à l'école ?
Le rêve …
Effondré. Le mot est bien trop faible pour dire ce qui vient de se passer. Un euphémisme.
Révolu. Cela ne rend pas le sens.
C'est comme si j'avais passé ma vie à vénérer un dieu, à l'honorer, me sacrifier pour lui, pour découvrir ensuite qu'il n'y avait pas le moindre dieu, que ce n'était qu'une illusion que j'avais rêvée, personnifiée, et qui venait de me trahir.
Le rêve.
Comment avait-il osé … ?
J'ai éteint la radio et j'ai laissé la voiture me conduire jusque chez Abderrahmane. Il était sur le balcon, regardant le ciel d'un air consterné.
Il m'a ouvert la porte et est entré dans la cuisine. Je l'ai suivi et l'ai regardé faire le café. Nous étions debout devant le réchaud, silencieux, les yeux fixés sur le café qui se mit à déborder sans qu'on s'en aperçoive.
Je l'ai laissé et suis sortie sur le balcon, cherchant quelque chose dans l'espace voilé. Un chien aboyait à côté dans un terrain vague où poussaient des herbes dont personne ne se souciait. Un enfant jambes et pieds nus est sorti en pleurant par le portail d'un immeuble. Son pied s'enfonce dans un trou … Il tombe … Ses pleurs redoublent … Il essuie ses yeux de sa main sale. Mon regard le suit vers le terrain vague et le chien. Ses aboiements diminuent et son corps se dresse à la vue de l'enfant.
Je pousse un grand soupir, espérant qu'il atteindra le ciel et que Dieu l'entendra. Où est-il en ce moment ? Est-il content de ce qui se passe ? Et s'il n'est pas content, pourquoi est-ce arrivé ?
Je suis retourné au salon. Abderrahmane était assis et regardait le mur en face de lui. J'ai pris le mégot qui menaçait de brûler entre ses doigts et l'ai éteint dans le cendrier où les mégots entassés formaient un monticule tortueux.
Je me suis assise sur une chaise face à lui et je l'ai observé. Son visage était creusé de rides profonds que je n'avais jamais vus. Il était très mat ; il n'était pas comme ça avant.
— Abderrahmane …
Il ne m'entendait pas. Il n'a pas levé les yeux du point qu'il fixait.
— Abderrahmane …
Soudain, sa voix a retenti : « Rien à faire … Rien à faire ». Puis, il a jeté la tête en arrière et fermé les yeux en continuant à marmonner : « Rien à faire ».
— Abderrahmane … J'ai besoin de toi.
Mes larmes ont commencé à couler malgré moi, puis à ruisseler. Je sanglotais.
— Abderrahmane …
Je me suis agenouillée près de lui et j'ai enfoui ma tête dans sa poitrine. Il est resté immobile. Puis ses doigts se sont enfoncés dans mes cheveux, tout doucement, et je me suis calmée un peu. J'ai levé la tête. Il gardait les yeux fermés. J'ai touché ses lèvres ; elles étaient mortes. D'un coup il m'a relevée et s'est mis debout. Je me suis agrippée à lui. Nous sommes allés au lit. Il m'a serrée contre lui sans regarder mes yeux qui l'imploraient. Il a essayé, essayé … En vain. Nous sommes restés silencieux.
Etrange. Ce n'était pas la première fois que nous avions des rapports sans parvenir à rien. Ce qui était surprenant, c'était la façon dont je m'élançais vers lui, haletante, comme s'il était mon sauveur, mon salut. Nos rencontres étaient à sens unique. Je n'étais jamais en phase avec lui. Je le prenais comme une mère prend son nouveau-né, comme l'enfant que je n'ai pas encore eu. Il s'est levé en me laissant derrière lui, tête baissée. J'ai séché mes larmes, enfilé mes habits, et je l'ai suivi. Nous sommes sortis dans la rue, observant les visages atterrés, pleins de stupeur ou d'hébétude.
— Quel idiot, il n'a pas su calculer son coup.
— Tu crois qu'ils l'auraient laissé calculer son coup ? Tôt ou tard, ils l'auraient attaqué.
Les mots trébuchaient sur nos lèvres. Nous nous sommes tus.
Il fallait faire quelque chose. J'avais commencé à m'engager politiquement avec mes camarades. Nous décidâmes d'organiser une marche de protestation à l'université après la fin des vacances de la mi-année, qui avaient duré plus d'un mois, en prévision de ce qu'ils appelaient les conspirations étudiantes. Certains étudiants connus pour leurs activités politiques avaient été arrêtés, ainsi que les agitateurs présumés de l'université, par mesure de sécurité.
C'était le premier lundi après les vacances. Mes camarades et moi sommes sortis de la faculté de lettres pour rejoindre un autre groupe sur le chemin de la faculté de droit. Nous nous sommes mis en rangs avec nos banderoles.
Non à l'invasion du Koweït
Non à une intervention américaine dans le monde arabe.
Non au sionisme.
Jérusalem, ville arabe.
J'étais à l'avant avec Samira, Soha et Safaa. A nos côtés, Youssef, Ali, et Ossama. Youssef menait la marche ; à l'époque, lui aussi était concerné par les affaires de son pays.
L'université ferma ses portes, comme toujours lorsque se produisaient des événements portant atteinte à la sécurité de l'université et de l'Egypte, comme déclara un officier de la sécurité. Les gardes avec leurs talkies-walkies étaient prêts à intervenir, de sorte que si les choses évoluaient, à Dieu ne plaise, les forces de la Sûreté centrale seraient là en quelques secondes pour répondre à l'attaque scélérate lancée par les gosiers des étudiants.
J'étais surprise, même si cela ne m'étonne plus aujourd'hui de voir que la plupart des étudiants ne s'intéressaient plus à ce qui arrivait à leur pays ni à eux-mêmes. Les yeux bandés, ils étaient occupés, ou faisaient semblant, à voyager et faire des fêtes … Je les maudissais - aujourd'hui j'ai pitié' d'eux. J'ai détournai le visage et me suis mise à entonner avec les autres, Pays, mon pays, à toi mon cœur et mon amour.
C'était la première fois que je prenais part à une manifestation étudiante, que je me mêlais à la foule avec mes camarades. Ma relation avec Abderrahmane, et avant ça avec Sanjay, m'avait éloignée de tout le reste. J'étais un peu comme ces étudiants que je venais de maudire. Et comme c'était la première fois, je ne me doutais pas des conséquences.
Après la manifestati, nous sommes montés à notre département. Je fus stupéfaite d'apprendre que Samira, Youssef et moi étions renvoyés de l'université. Ce n'était pas nouveau pour Youssef, qui avait déjà été renvoyé et emprisonné, mais Samira et moi n'avions jamais connu ça. Nous sommes descendues ensemble voir le responsable pour lui demander des explications.
— Je vous ai renvoyées parce que vous avez perturbé les cours et saccagé des plantes qui nous ont coûté cinq cents livres.
— Nous n'avons pas marché sur les plantes, ai-je rétorqué, ni perturbé les cours. Vos étudiants passent leur temps à organiser des fêtes et des excursions et à vendre des billets.
— Ce que vous avez fait est une haute trahison, ce n'est pas un renvoi que vous méritez. C'est la peine capitale.
J'ai failli m'exclamer de colère. Samira m'a fait les gros yeux. Le responsable l'a regardée en disant : « Et en plus, ça porte du rouge. Communiste ! ».
Samira s'est montrée surprise et lui a demandé ce que cela voulait dire. J'ai bien aimé sa repartie, qui a mis fin à la conversation.
Nous avons été exclues pour un mois. Je ne l'ai pas dit tout de suite à mes parents. Mon père était au Caire, je ne voulais pas le contrarier ou l'inquiéter. Et puis je savais très bien qu'il ne me soutiendrait pas, parce qu'il était partisan du Occupe-toi de tes affaires. Comme si mes affaires étaient distinctes de celles de la société.
Ce jour-là, je suis rentrée chez moi. Je n'ai parlé à personne. Je suis rentrée dans ma chambre et l'ai arpentée de long en large jusqu'à l'heure du dîner. Puis je suis sortie et j'ai raconté ce qui s'est passé. « Ne te mêle pas à ces histoires ma fille, occupe-toi de tes affaires. Ce que vous faites là ne sert à rien. Untel a assisté à une manifestation il y a cinquante ans ; jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il se passe quelque chose il se fait arrêter … Pourquoi t'attirer des ennuis, et à nous aussi … Tu vas te faire malmener pour rien. Vous n'arriverez à rien ».
Je me suis enfuie dans ma chambre, m'abritant entre ses murs sourds. J'ai appelé Abderrahmane et lui ai raconté …
— Ils ont raison, tu feras mieux de les écouter.
Sa réponse me consterna. Comment, lui, pouvait-il dire une chose pareille.
J'ai mis fin à la conversation et reposé le combiné, me frappant une paume contre l'autre. Ils ont raison, tu feras mieux de les écouter …
Nous n'avons rien pu changer. Et nous sommes encore là à piétiner sur des chemins brumeux. Est-ce qu'ils avaient raison ? Nous sommes-nous trompés ?
Des questions, encore des questions.
(…)
Abderrahmane m'a téléphoné un peu plus tard. Il voulait me voir. Je n'en avais pas envie, mais j'y suis allée quand même. Il n'allait pas bien. Je lui ai fait quelque chose à manger. Puis j'ai commencé à lui faire un café.
— Le café a débordé, ai-je dit en me libérant de son étreinte.
J'ai entrepris d'en refaire un. Mais il ne m'a pas laissé faire. M'attrapant par le bras, il m'a entraînée dans sa chambre et a jeté le poids de son corps chaud et fébrile sur mon corps inerte. J'ai senti que je le haïssais. Que je ne le supportais pas. Je ne sais pas si cela m'a prise brusquement ou si c'était une accumulation de choses qui se révélaient là, à cet instant.
J'avais la nausée ? Je me suis mise à vomir en pleurant.
Je l'ai laissé là et je suis allée au bord du Nil, mon refuge, mon sanctuaire.
Traduit de l'arabe par Stéphanie Dujols
Trois Valises pour partir
By: Mona Prince - on: Wednesday 20 December 2017 - Genre: Stories
Upcoming Events
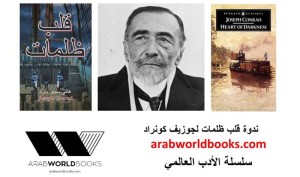
Joseph Conrad's Heart of Darkness Discussion
April 27, 2024
Join us for a special discussion of Joseph Conrad&...

A writer, a vision, a journey: a conversation with Francis Boyle
February 24, 2024
This event took place on 24 February 2024 Yo...

Discussion of Fawzia Assaad’s An Egyptian Woman
November 25, 2023
In celebration of the life and outstanding achieve...

Toni Morrison's The Bluest Eye, A Presentation and Discussion
October 28, 2023
This presentation and discussion of Toni Morrison&...
