Pas facile de s’assumer travailleur du bâtiment quand on est romancier et que l’on appartient à une famille bédouine. C’est ce que raconte l’écrivain égyptien Hamdi Abou-Goulayel dans son dernier roman, Etre manœuvre (Merit).
Traduction de Dina Heshmat L'Ahram Hebdo 3-9 septembre 2008
J’ai fumé le joint. Il était fort. Chaque fois que j’en fume un, je dis qu’il est fort, que « c’est du bon ». Mais celui-ci était particulièrement fort, je le sentais. Le bout de shit aurait suffi pour cinq bons joints. Si j’avais été avec des amis, j’en aurais fait huit ou même dix, mais je n’en ai fait que trois. Je m’encourageais en me disant que c’était utile pour réfléchir au roman. Chaque joint, je le roulais de manière différente et me disais : je vais commencer avec. Je préfère toujours commencer par ce que je pense être le plus faible, le plus mauvais. A cause de quelque défaut de fonctionnement, je ne me fie qu’aux dénouements heureux. Je n’ai pas l’intelligence de cueillir d’abord la chose la meilleure. Si j’ai deux livres, je commence par celui que je pense être le moins bon. A table, je prévois que la dernière bouchée sera celle que j’aime vraiment. J’appartiens à un peuple qui remet sa part de viande à la dernière bouchée. Ce joint était le moins bon, c’était le deuxième dans l’ordre de fabrication : j’en avais roulé un avant et un après. Au premier joint, je suis avide de shit, avide de ses petites particules qui tombent, légères, dans la bouche de la cigarette ouverte entre mes mains. Au deuxième ou bien au milieu je deviens économe, voire avare. C’est pas simple comme affaire. Le chemin est long avant de se retrouver seul et de commencer à rouler. N’étends pas ta main trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Le dernier joint est du shit pur, c’est là que se retrouvent les particules de shit les plus lourdes qui ont échappé au tabac. Mais ce joint était suffisant. C’était une bonne idée de diminuer la quantité de tabac. C’était le genre de joint à te rendre satisfait de toi-même, à te faire sentir que tu as toute la vie devant toi. Les tours que je fais dans la chambre maintenant sont l’indication la plus évidente de mon bonheur, la preuve que « c’est du bon ». Les idées me font trembler presque.
Dans ces moments-là, je m’imagine ma vie comme des dossiers classés dans ma tête. Tantôt, ils s’ouvrent un à un, tantôt, ils se déversent d’un seul coup et les souvenirs d’enfance se mêlent aux traits de la dernière personne que j’ai rencontrée. Maintenant, je me vois à Choubra. J’avais vingt ans, et je rentrais d’un voyage en Libye. J’étais manœuvre, dans le bâtiment, et passais mon temps à chercher du boulot. J’habitais une chambre à Aïn-Chams avec quatre collègues du balad. Je travaillais avec un entrepreneur-démolisseur, ou plutôt un démolisseur-constructeur, qui ne s’occupait que des bâtisses en ruine. Les bâtisses scellées à la cire et qui avaient fait l’objet d’un décret définitif de destruction étaient au cœur de son travail. Il détachait les scellés rouges, avec une délicatesse correspondant à son statut officiel et s’introduisait dans la maison avec un bataillon d’ouvriers. Une équipe creusait les fondations tandis qu’une autre coulait les piliers et les murs. En quelques jours seulement se réalisait le miracle, et la maison en ruine devenait un grand immeuble de toutes les couleurs. La plupart des vieilles maisons à Choubra et dans les environs lui doivent d’être encore debout.
Moi je travaillais avec lui avec tout le sérieux et la fidélité du monde. Il me considérait comme proche de lui et me traitait mieux que les manœuvres, car il voyait en moi une bête de somme et parce que mon regard restait rivé à terre. Au moment du tremblement de terre qui a secoué Le Caire en 1992, j’étais en train de creuser les fondations sous une maison de trois étages. Mais je racontais aux gens, même les plus proches, que j’étais journaliste. J’utilisais mes nouvelles qui avaient été publiées pour confirmer que je travaillais effectivement comme journaliste dans le journal Al-Ahrar, dont je sentais qu’il correspondait à ma situation. Parfois, je disais que je continuais mes études. Si quelqu’un me demandait dans quel domaine, j’étais gêné et embarrassé. Quand j’appris qu’il existait un « Institut de critique littéraire », le nom imposant, « critique littéraire », me plut. Je me mis à raconter fièrement que j’étudiais à « l’Institut de critique littéraire ». J’étais constamment à la recherche d’un emploi, n’importe lequel, un travail respectable qui commence à huit heures du matin et se termine à deux heures de l’après-midi. Je me présentai à des dizaines de ministères, d’entreprises et de bureaux dans tout Le Caire. Un jour, je me présentai à une institution culturelle avec un collègue du balad. On avait lu dans une annonce que la respectable institution avait besoin d’un responsable culturel. Mon collègue avait dit : « Vas-y l’écrivain, montre-nous ce que tu sais faire ».
Nous nous dirigeâmes vers là-bas. Ce n’était pas très loin, le siège du jury était à deux stations du café. L’examinateur était un homme âgé ; il était énorme, avait les cheveux crépus, d’une blancheur éclatante ; sur son bureau, un écriteau indiquait son nom et son poste.
D’expérience, je savais qu’il aurait dû nous faire passer l’examen un à un, mais pour une raison que je ne connais pas, il nous aligna tous et commença à travailler. Il y avait moi, mon collègue, et environ huit jeunes diplômés, mais son bureau était spacieux. Il semblait être à la recherche de questions à la hauteur de l’emploi escompté. Plus tard, je me suis souvenu, ou plutôt imaginé, que son bureau était encombré de cassettes. J’étais le premier de la rangée. Mon collègue, pour des raisons qui se clarifieront plus tard, m’avait poussé à cette place. L’examinateur était exactement en face de moi. Il était fier de s’étaler derrière son bureau tandis que nous nous bousculions devant lui. Il semblait douter de notre droit à ce poste et menait l’examen avec la nonchalance de qui en connaît l’issue. Il me regarda sans intérêt, puis demanda soudainement : « Je te fais confiance, ma belle : si je te confie un secret, tu sauras le garder ». Avant que je n’aie le temps de réaliser ce qui se passait, il me surprit : « Qui a dit ça ? ». J’éclatai de rire. J’avais entendu cette chanson souvent. Parfois, je la fredonnais. Mais je ne m’imaginais pas qu’un homme aussi respectable puisse la chanter. En plus, sa façon d’étirer les paroles, de prendre une expression coquette, et son éruption au moment où il me surprit ou plutôt me poignarda de sa question était quelque chose d’inénarrable. J’essayai de m’excuser, faillis lui baiser les mains. Je dis que je venais de la campagne, que je m’étais rappelé quelque chose de drôle. Mais il fut inébranlable. L’examen serait annulé, pour moi, pour mon collègue et pour tout le monde.
Si ce n’est ce rire absurde, je serai devenu un responsable culturel respectable. D’eux tous, j’en étais le plus proche. J’avais un dossier avec mes écrits publiés dans les journaux. Mais il ne servait à rien de regretter. La question était plus profonde qu’un simple rire. Moi je suis terrorisé par ces choses. Sortir des dossiers et rester debout dans une queue, respecter les gens selon leur rang. Je trouvais ça humiliant. J’avais le sentiment de mendier. Le bâtiment, c’était plus facile. J’avais l’impression que je ne pourrais faire aucun autre travail, et même, parfois, que mon intérêt pour l’écriture venait de là. Bien sûr, j’aimais la réussite, l’excellence. Mais je n’avais pas confiance en mes capacités. Je les trouvais souvent décevantes. Le prix à payer pour réussir était très élevé, l’écriture me permettait d’éviter de le payer. Ma capacité à m’exprimer semble me faire défaut, comme d’habitude. Ce que je veux dire, c’est que l’écriture me permettait d’être fier de moi-même. Même quand je soulevais des charges de boue, le simple fait de me souvenir que j’écrivais des nouvelles remettait les choses à leur place .
translation into French by Dina Heshmat
Les dossiers sont dans la tête, mon ami
By: Editor - on: Monday 25 December 2017 - Genre: Book Reviews
Upcoming Events
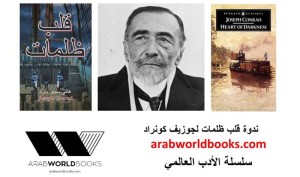
Joseph Conrad's Heart of Darkness Discussion
April 27, 2024
Join us for a special discussion of Joseph Conrad&...

A writer, a vision, a journey: a conversation with Francis Boyle
February 24, 2024
This event took place on 24 February 2024 Yo...

Discussion of Fawzia Assaad’s An Egyptian Woman
November 25, 2023
In celebration of the life and outstanding achieve...

Toni Morrison's The Bluest Eye, A Presentation and Discussion
October 28, 2023
This presentation and discussion of Toni Morrison&...
